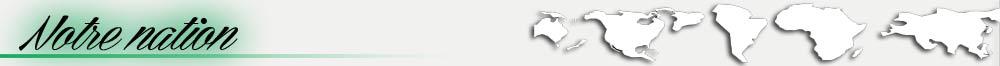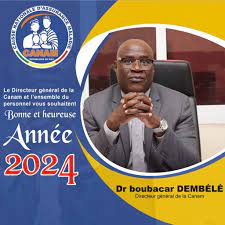Societe > Mali : paix et religions

Mali : paix et religions
jeudi 11 septembre 2025, par
Un décalage entre l’enseignement religieux et le vécu quotidien.
L’amour du prochain et la fraternité, le pardon et la paix, le respect de la vie et de la dignité humaine, la justice et l’équité, la recherche du bien et le rejet du mal, la cohésion comme valeur centrale pour l’unité, la paix et le vivre-ensemble et gage d’une paix durable,... Telles sont les principales valeurs morales et religieuses universelles enseignées par les leaders religieux, la société civile et les hommes de culte au Mali.
Mais, avec l’escalade actuelle des messages de haine, il est difficile de concilier les idéaux moraux et spirituels avec le vécu quotidien. Au Mali, les religions jouent un rôle social et politique crucial, influençant la vie quotidienne et la mobilisation sociale.
Et la laïcité de l’Etat est un principe consacré par la Constitution. Dans la pratique, le pays a toujours favorisé la liberté d’expression pour toutes les confessions religieuses. Ce qui promeut le vivre-ensemble, à travers notamment des initiatives comme les journées interconfessionnelles pour la paix. Cependant, des messages de haine, d’intolérance et d’extrémisme religieux prolifèrent ces dernières années, exacerbés surtout par les réseaux sociaux.
De quoi raviver les tensions et polluer la vie dans des communautés. Pour Modibo Kampo, Coordinateur national du Forum national des organisations de la société civile du Mali, l’extrémisme violent et l’intolérance religieuse constituent de véritables freins culturels et politiques. « L’exercice de la politique partisane occasionne, en plusieurs endroits du pays des fissures au niveau des relations séculaires entre familles, communautés, voire des conflits ouverts et violents. Et ces derniers causent parfois, à leur tour des crises et même mort d’hommes », explique-t-il.
D’après lui, au lieu de consolider les liens ancrés entre les communautés et les familles, la politique partisane et le repli identitaire constituent des vecteurs de délitement du vivre ensemble et d’effritement du tissu social légués par les ancêtres.
Pour contrer les messages de haine, les leaders religieux multiplient des initiatives, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. « Notre philosophie, c’est que si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton prochain. C’est pourquoi, Jésus prône le pardon », note Daniel Coulibaly, catholique retraité et personne ressource de la Conférence Episcopale du Mali. Pour lui, c’est pour favoriser l’entente entre les enfants du pays que l’église catholique a entre autres mis en place un enseignement inclusif, qui ne cherche pas à transmettre le savoir religieux et ouvert aux enfants et au personnel non chrétiens.
Quant au Haut Conseil Islamique du Mali (HCI), il a initié un renforcement des capacités sur la bonne manière de conduire les prêches en suivant les règles et les limites, dans les mosquées ou en dehors de ces dernières. « Cela a été une réussite avec l’aide et les recommandations du Président de la transition, Chef de l’Etat. Qu’on se donne la main, le contexte nous interpelle tous. Pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble », ajoute Mohamed Maky Bah, vice-président du HCI.
Réactiver l’entente interreligieuse
Selon Daniel Coulibaly, chaque fois qu’elle en a les moyens et dans la mesure du possible, l’Eglise Catholique accompagne tout le monde. « La discipline appliquée est de faire en sorte qu’il y ait le respect entre les uns envers les autres. A l’école catholique, la moitié des enseignants sont musulmans. On essaie de traiter tout le monde au même pied d’égalité, dans le respect pour adoucir l’atmosphère. L’église ouvre ses portes à tout le monde », explique-t-il.
De son côté, Sidiki Coulibaly, président de la Fédération Nationale des chasseurs traditionnels (Donso) de la commune 1 et 2 de Bamako, rappelle que la volonté divine est que chaque Musulman, Chrétien ou homme de culte respecte son prochain. « La fédération (nationale des chasseurs) est basée sur la tolérance. Elle a toujours prôné le respect des uns envers les autres et a toujours forgé l’entente », dit-il.
Pour lui, si on se donne la main, la paix que tout le monde préconise deviendra une réalité. C’est pourquoi, il appelle les adeptes de toutes les religions au vivre ensemble, comme un impératif. D’après lui, les actions de l’association « An ka ben maya la (Soyons Solidaires Aidons - Nous les uns les autres) » interpellent tout le monde, Musulmans, Chrétiens et hommes de culte. « Dans le contexte actuel, chacun doit avoir un comportement qui unit et bannit le discours de haine », recommande-t-il.
Le HCI prône aussi la paix et la cohésion sociale. Selon Mohamed Maky Bah, cette institution a comme premier rôle de consolider la paix et la cohésion sociale entre Musulmans. C’est cela qui justifie, dit-il, la mise en place au sein du HCI, d’une commission nationale pour la paix et la réconciliation. Il rappelle que le Mali a toujours préconisé l’union, la paix et la cohésion sociale entre tous ses fils et toutes ses filles et surtout entre les religions. « Il y a toujours eu entente rentre les deux principales religions (le Christianisme et l’Islam). On fait presque tout ensemble, pour ce qui concerne la vie de la nation », reconnaît-il.
Une société civile dynamique
D’après Diakité Djénébou Sangaré, Présidente de l’Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati, les religieux jouent un rôle important dans la consolidation de la paix, la résolution des conflits et le vivre ensemble. « Chacun doit préconiser la paix, le vivre ensemble, connaître ses limites, ses droits ainsi que ses devoirs et se rappeler que le Mali est un pays laïc », précise-t-elle.
De son côté, Modibo Kampo estime que la religion peut être un puissant facteur de cohésion sociale, tant qu’elle reste dans les limites de la tolérance réciproque entre différentes confessions existant sur le même territoire. La société civile peut aussi jouer un rôle important dans l’apaisement des différents courants religieux et de culte en situation de belligérance. En effet, dit-il, « la société civile en se mettant à équidistance de toutes les parties en conflit ou en situation de désaccord profond sur un sujet d’intérêt collectif, peut jouer le rôle d’interface et de facilitateur de dialogue. Elle peut jouer un rôle de catalyseur et de rapprochement des positions lorsque ces dernières sont profondément opposées en s’appuyant sur sa stratégie de diplomatie non-gouvernementale ».
Pour lui, les initiatives religieuses peuvent être porteuses d’espoir et constituer des facteurs de réconciliation, à condition de respecter la tolérance religieuse réciproque (les uns reconnaissant l’importance des autres dans la gestion des sujets d’intérêt communautaire ou national). « Les leaders religieux peuvent être sollicités, notamment pour passer les mots d’ordre et les appels à la paix et à la cohésion sociale », estime-t-il.
Pour jouer pleinement ce rôle en tant que recours finaux, il rappelle que ces leaders religieux doivent se tenir à l’écart de l’arène politique et des luttes partisanes. Ainsi, dit-il, ils gardent leur statut de garant moral et d’ambassadeurs de la paix et de la réconciliation.
Bintou Coulibaly, membre de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM)
NB : Cet article s’inscrit dans le cadre du projet « Sous l’arbre à palabre de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) », avec le soutien technique et financier de l’ONG ORFED, dans le cadre du Programme Promouvoir une Paix Durable au Mali (PPDM), financé par la coopération allemande, à travers le Service Civil pour la Paix (SCP) d’EIRENE.
Voir en ligne : Mali : paix et religions