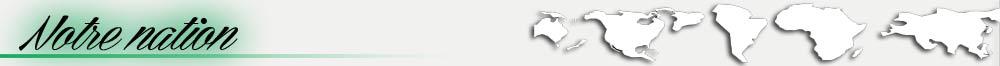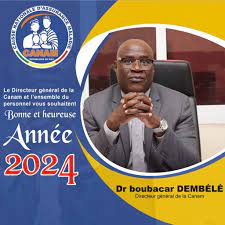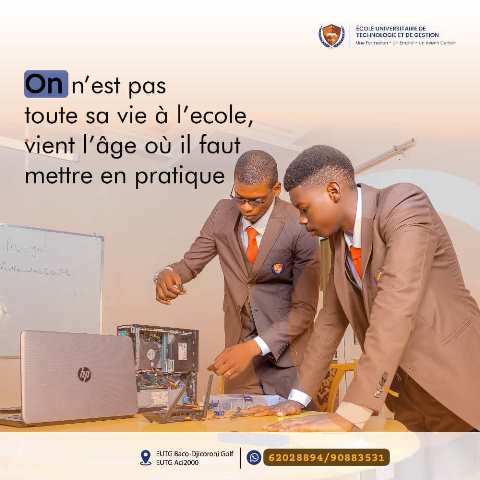Actualités > Une note de Joseph Brunet-Jailly sur les rémunérations des agents de l’Etat au Mali

Une note de Joseph Brunet-Jailly sur les rémunérations des agents de l’Etat au Mali
jeudi 11 octobre 2018, par
Les mouvements sociaux qui agitent le Mali depuis 2017 imposent d’examiner les rémunérations des agents de l’Etat au Mali en prenant un peu de recul.
L’extrême faiblesse des gouvernements qui se sont succédé depuis le début 2007 les a amenés à accepter des revendications considérables (tel l’octroi de statuts dérogatoires alors que la Constitution énumère limitativement les corps à statut) et d’importantes révisions des grilles indiciaires. Ces décisions concourent-elles à une plus grande justice ? À la lutte contre la pauvreté ?
Deux points seront abordés ci-dessous : i) quelle est la validité de la comparaison entre les salaires maliens et ceux des pays voisins ? ii) que sait-on de l’évolution des salaires de certaines catégories d’agents de l’Etat au Mali ?
La comparaison avec les pays voisins
Chacun sait qu’il convient de comparer ce qui est comparable. Comparer les salaires maliens aux salaires des pays voisins, c’est supposer que l’économie malienne est comparable à l’économie des pays voisins. Qu’en est-il ?
Le meilleur étalon disponible pour une comparaison des niveaux de vie entre pays est le produit national brut par tête en parité de pouvoir d’achat. Cette variable est exprimée en dollar international, une unité monétaire commune étant nécessaire à la comparaison entre pays. La base de données de la Banque Mondiale fournit ce chiffre sur une longue période, et nous avons choisi d’en donner une représentation graphique pour les vingt cinq dernières années et pour onze pays d’Afrique de l’Ouest (graphique 3).
Il apparait immédiatement que le Ghana, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire ont dans les dernières années un produit national brut par tête en parité de pouvoir d’achat compris entre 3000 et 4000 dollars internationaux, pendant que le Sénégal est à 2250 environ, le Mali, le Bénin et le Tchad étant tout près ou juste en dessous de 2000, le Burkina Faso à peine au-dessus de 1500 et le Niger à 1000.
Il n’y a donc pas grand sens à comparer la situation des fonctionnaires du Mali à celle des agents de l’Etat en Côte d’Ivoire par exemple, pays dont les citoyens ont en moyenne un niveau de vie deux fois supérieur à celui du Mali. Dans la comparaison avec le Sénégal, il faudrait immédiatement tenir compte d’une différence –en faveur du Sénégal– de l’ordre de 10 %.
Cela dit, il faut bien admettre que, s’il est vrai que le Burkina Faso paie beaucoup mieux ses magistrats que ne le fait le Mali, cela ne tient pas au fait que le « pays des hommes intègres » aurait en moyenne un niveau de vie supérieur à celui des Maliens. Depuis longtemps les fonctionnaires du Burkina Faso sont en Afrique ceux qui bénéficient du multiple le plus élevé du PIB par tête2.
L’examen du contexte dans lequel sont définies les rémunérations des fonctionnaires doit donc être un peu plus approfondi : la société peut vouloir disposer d’une administration compétente et intègre, comme elle peut s’accommoder d’une administration nombreuse et inefficace, c’est-à-dire préférer une large redistribution sans recherche d’efficacité à une redistribution plus étroite au profit d’agents dont on attend des services de qualité.
En second lieu, les données en parité de pouvoir d’achat permettent de voir que la croissance a été inégale, entre les pays observés, sur la longue période de vingt-cinq ans. Ainsi, la moyenne des taux de croissance annuels du produit national brut par tête en parité de pouvoir d’achat est de 2,9 % au Ghana, de 2,8 % au Tchad, et de 2,6 % au Burkina Faso, elle n’est que de 1,7 % au Mali, de 0,8 % au Sénégal. Ce sont des moyennes de longue période : mais sur vingt-cinq ans, 2,9 % par an conduit à un doublement, alors que 1,7 % ne permet d’obtenir qu’un accroissement de 50 %, et 0,8 % un accroissement de 20 % seulement. De ce point de vue, aussi, les performances des pays voisins du Mali sont très différentes des siennes, qui apparaissent plutôt médiocres.
On doit considérer, en troisième lieu, que, même à niveau identique de produit national, les Etats voisins n’ont pas la même capacité à verser les mêmes salaires : cette capacité dépendra en particulier de la part du produit national qui est captée par l’Etat pour financer les charges d’intérêt général de la Nation (dont les rémunérations des fonctionnaires). On peut utiliser ici les données de la BCEAO, disponibles sur une longue période. Au Mali, en 2015, la recette fiscale par habitant est de 20.000 FCFA ; elle est très inférieure à celle du Burkina Faso (50.000 FCFA), plus encore à celles du Bénin (69.000 FCFA) ou du Togo (74.000 FCFA) ou du Sénégal (111.000 FCFA). Et comme on le voit, ces écarts entre les efforts fiscaux des divers pays ne sont pas liés aux écarts de revenu moyen par tête : par exemple, le Burkina Faso n’a pas une économie plus riche que celle du Mali, mais sa recette fiscale par habitant est bien plus élevée.
En outre et surtout, il s’agit là d’une situation de longue période. Sur les 27 ans qui vont de 1990 à 2016, les chiffres sont sans appel : en moyenne annuelle sur cette période, au Togo l’Etat dispose de 16 % du PIB3 du pays, en Côte d’Ivoire et au Sénégal de 14 %, au Burkina et au Mali de 10 %, au Bénin de 8 % seulement. Deux présentations de cette situation sont concevables : on peut dire ou bien que l’Etat au Mali n’a pas jugé bon de se procurer les ressources nécessaires à une stratégie plus ambitieuse, ou bien que les citoyens de ce pays ont refusé à leur Etat les moyens d’une véritable stratégie de développement.
Dans le premier cas, c’est la clairvoyance et la détermination des dirigeants politiques qui est en cause, dans le second, c’est la courte-vue des citoyens qui se réjouissent chaque fois qu’ils peuvent échapper à la douane ou obtenir une exemption fiscale, sans se rendre compte que la Nation a besoin d’un Etat capable de défendre les intérêts collectifs dans la compétition internationale4.
Les deux interprétations sont complémentaires, mais il y a là une forme de choix de société. De ce point de vue le Mali a maintenant une tradition d’administration pauvre et de citoyens plus soucieux de « manger leur blé en herbe » que de poser les bases d’un développement solide. La conclusion s’impose : d’une part, le Mali n’a pas les mêmes moyens que certains de ses voisins chez lesquels les fonctionnaires sont mieux payés ; d’autre part, chaque pays a une histoire plus ou moins favorable à ce que les fonctionnaires aient des rémunérations relativement élevées, et celle du Mali n’y est pas spécialement favorable. En effet, au cours des décennies, la tendance de l’Etat (c’est-à-dire de ses dirigeants politiques, de ses cadres supérieurs, de ses syndicats,…) a souvent été de favoriser la redistribution en embauchant beaucoup de petits salaires ou d’agents mal formés, plutôt que de bâtir une administration peu nombreuse, très compétente, très efficace, incorruptible et bien payée. On se souvient par exemple qu’on a recruté en masse des instituteurs non qualifiés sous le régime de Moussa Traore, et qu’on n’a pas cessé depuis.
La comparaison interne entre groupes sociaux
La fixation des rémunérations et la détermination des niveaux de vie sont des éléments décisifs de la paix sociale, probablement plus importants que tout. C’est donc un équilibre accepté par tous entre les niveaux de vie des différents groupes sociaux qu’il faut viser. De quelles données dispose-t-on pour apprécier cet équilibre ?
D’abord, l’INSTAT fournit des données abondantes sur l’incidence de la pauvreté selon les milieux sociaux. La dernière enquête publiée (2016-2017) considère qu’il faut disposer de 178 000 FCFA (par tête et par an) pour satisfaire ses besoins de base ; au même moment la proportion de la population qui se trouve en dessous de ce seuil est estimée à 44,9 %. Mais cette proportion est très variable d’un groupe socio-économique à l’autre : alors qu’elle est de 45 à 47 % dans les groupes agricoles, il faut se rendre à l’évidence qu’elle ne dépasse pas 7,6 % dans le groupe des salariés du secteur public5.
Qu’on le veuille ou non, la lutte contre la pauvreté ne peut pas négliger cette caractéristique de la situation sociale : l’incidence de la pauvreté est bien plus considérable chez les ruraux que chez les salariés, et notamment chez les salariés du public.
En second lieu, on voudrait voir comment ont évolué les rémunérations des agents de l’Etat par rapport à la richesse nationale. Comme nous ne procédons pas ici à des comparaisons entre pays, nous utilisons le Produit Intérieur Brut par tête, qui est donné en FCFA par la BCEAO en série longue (1990-2015) à partir des données que lui transmet le Mali. Cette série montre comment a évolué le niveau de vie moyen au Mali, elle peut servir d’étalon pour dire si un groupe social particulier a été avantagé ou désavantagé au cours de la période.
En ce qui concerne les rémunérations des agents de l’Etat, il faut examiner deux éléments : d’une part la valeur du point d’indice, d’autre part l’échelle indiciaire et les primes et avantages en nature qui s’ajoutent à la rémunération de base. Examinons d’abord la série des valeurs du point d’indice selon le Ministère de l’Economie et des Finances : si la valeur du point d’indice évolue comme notre étalon, on saura que les rémunérations des agents de l’Etat ont suivi exactement le cours du niveau de vie moyen au Mali. Qu’en est-il ? Le graphique ci-dessous le montre.
On voit donc sans l’ombre d’un doute que la valeur du point d’indice, en rouge, a augmenté moins vite, en tendance, que le PIB par tête, et notamment pendant la décennie ATT et les premières années du premier mandat d’IBK. Il est donc parfaitement évident que, sur la période de 25 ans que nous examinons, mais tout spécialement depuis 2001, le niveau de vie des agents de l’Etat dans leur ensemble a perdu du terrain par rapport au niveau de vie moyen au Mali.
L’autre élément à considérer pour préciser la rémunération des agents de l’Etat est évidemment la grille indiciaire et les primes qui peuvent compléter le salaire de base. Il n’est pas possible ici de traiter de l’ensemble des corps professionnels, et le choix s’est porté sur la profession qui est entrée la première dans la lutte syndicale pour obtenir une revalorisation de ses rémunérations : les magistrats. Mais même pour ce corps, il n’est pas question de considérer tous les grades, groupes et échelons, car on cherche à mettre en évidence une tendance de longue période, et pas des différences individuelles.
Pour illustrer la tendance de longue période (1990-2015), on considère donc ci-dessous simplement la rémunération de début de carrière (2e grade 2e groupe 1er échelon) et la rémunération de fin de carrière (grade exceptionnel).
On calcule les rémunérations en utilisant les indices, la valeur du point d’indice et les primes. Les rémunérations ainsi calculées sont comparées à l’étalon, le PIB par tête, sur le graphique ci-dessous :
La révision des indemnités de judicature apparait très clairement sur le graphique en 2010. De même, les années 1999 à 2003 ont été favorables à l’évolution des rémunérations de ce corps (indemnité de logement en 1999, indemnité de judicature en 2000…). Plus généralement, la part des primes est croissante dans les rémunérations des magistrats : elle était de l’ordre de 25 % dans les années 1990, elle est désormais proche de 60 % pour les magistrats en début de carrière, et de 40 % pour ceux qui sont aux plus hauts postes.
Le graphique montre aussi que la courbe de la rémunération du magistrat débutant suit à peu près l’évolution de la courbe du niveau de vie moyen au Mali (pas son niveau, sur lequel on revient ci-dessous). Et contrairement à l’impression qu’il donne, le graphique ne montre pas que la courbe de la rémunération du magistrat en fin de carrière croitrait plus vite que celle du débutant : c’est le contraire, comme le montre le calcul du taux de croissance annuel moyen sur la période de 22 ans (6 % pour la courbe de fin de carrière, 7,5 % pour la courbe de début). Comme le PIB par tête est une valeur pour l’année entière, si on veut le comparer aux rémunérations mensuelles, il faut multiplier ces dernières par douze. Il apparait alors que la rémunération des magistrats débutant est de l’ordre de 14 fois le PIB par tête, sans changement significatif entre la première et la dernière année de la période ; quant aux magistrats qui atteignent les plus hauts postes, ils obtenaient environ 32 fois le PIB par tête en 1993, mais ils ne reçoivent pas plus de 23 fois ce montant en 2015. Il s’est donc produit un sensible tassement de la hiérarchie au détriment des plus hauts postes.
Ce dernier point mériterait un éclaircissement. En particulier on pourrait se demander s’il résulte d’un acquiescement de la hiérarchie ou d’une pression de la base.
Plus généralement, dans la perspective d’équilibre social qu’on a évoquée plus haut, la question est de savoir si la société accepte de payer entre 14 et 23 fois le PIB par tête aux magistrats parce qu’elle attend, pour ce prix, de voir la justice s’exercer dans d’acceptables conditions d’équité, d’honnêteté, d’incorruptibilité, ou si la justice est aux mains d’un groupe de pression qui cherche d’abord à tirer le maximum d’un Etat moribond avant de se retourner vers les plaignants pour les mettre à contribution eux aussi sans état d’âme.
Dans une démocratie, le législateur et l’exécutif ne devraient pas pouvoir éviter longtemps de tenir compte des opinions recueillies dans la population sur ce sujet. Or au Mali il apparait que près de deux tiers des personnes enquêtées (63,2%) en 2016 pensent que la corruption est très élevée (et cette proportion atteint 75 % à Bamako7) ; et, hélas, la justice est chaque fois le premier secteur d’activité cité (41 %)
Mais si, alors que le législateur a fait son travail, l’exécutif n’est pas capable de transmettre les dossiers à la justice, ou la justice ne traite pas les dossiers transmis, ou les jugements ne sont pas exécutés, ou encore – sous les menaces d’un groupe de ses propre agents– l’exécutif se montre incapable de faire fonctionner l’organe de lutte contre l’enrichissement illicite, alors la société est dans une situation dramatique. On ne peut plus en effet écarter l’hypothèse que ce à quoi nous assistons corresponde à une réaction sociale inévitable : si, du fait de la corruption de la justice, on est dans l’extra-judiciaire même lorsqu’on s’adresse au juge, alors la rémunération du juge est en concurrence avec celle de l’homme de main ; c’est à celui qui fera le travail pour le prix le plus abordable qu’on s’adressera ; et l’on sait qu’à ce jeu la justice corrompue est trop chère par rapport au crime organisé. Là est en tous cas le risque mortel pour la société de l’effondrement de l’autorité morale et de la respectabilité professionnelle de la justice.
Joseph Brunet-Jailly
8 octobre 2018
Qui est Joseph Brunet-Jailly ?
Docteur ès sciences économiques en 1967, agrégé de l’enseignement supérieur en sciences économiques en 1970, Joseph Brunet-Jailly a été assistant à la Faculté des sciences juridiques, politiques et économiques de Strasbourg de 1962 à 1968, puis chargé de cours et ensuite maître de conférences à la Faculté des Sciences Economiques d’Aix-en-Provence, avant d’y être nommé professeur (1975), puis élu doyen (1979-1982).
Alors spécialiste reconnu de l’économie du système de santé français et de l’économie des systèmes d’assurance maladie des pays d’Europe, il sera à sa demande détaché en 1986 à l’ORSTOM, pour prendre à Bamako (Mali) la direction d’un projet conjoint de l’ORSTOM et du Ministère français de la Coopération. Ce projet avait pour objectif de former, en partie sur place et en partie dans les universités européennes, de jeunes diplômés maliens à la recherche dans les sciences sociales de la santé (économie, sociologie-anthropologie, épidémiologie). Pendant l’exécution de ce projet, qui s’est étendue de 1986 à 1995, le Professeur Brunet-Jailly a complété sa formation en acquérant une connaissance approfondie des systèmes de santé d’Afrique de l’Ouest, et a choisi de quitter l’Université pour devenir directeur de recherches à l’ORSTOM (désormais connu sous le nom d’Institut de Recherche pour le Développement –I.R.D.).
En 1995 il a été affecté à Abidjan où il est resté jusqu’en 2000, travaillant sur l’économie de la lutte contre le sida, avant de revenir à Bamako en qualité de Représentant de l’IRD (2000-2004). C’est au cours de son séjour à Abidjan qu’il a été confronté à la nécessité de réfléchir à l’éthique médicale de la décision de santé publique.
Depuis 2004, il exerce en qualité de consultant indépendant (essentiellement pour les institutions internationales spécialisées, actuellement en relation avec le Center for Global Development, de Washington) et il est chargé d’enseignement à Sciences-Po.
Selon le site : http://www.sciencespo.fr
Voir en ligne : Une note de Joseph Brunet-Jailly sur les rémunérations des agents de l’Etat au Mali