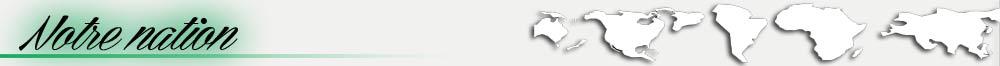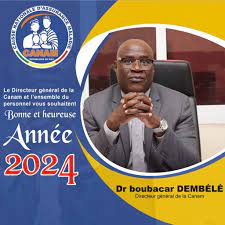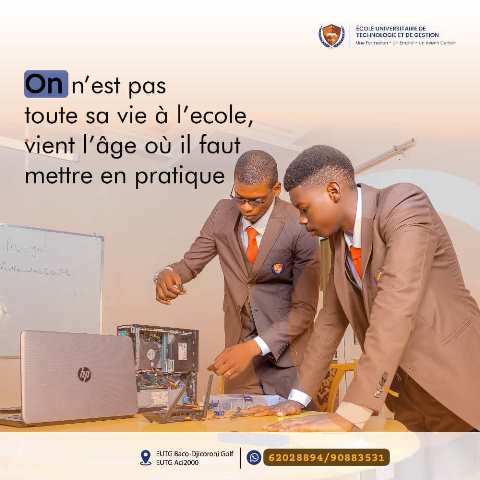Actualités > Droits de l’Homme au Mali : Amnesty International dépeint un tableau sombre dans son rapport 2020

Droits de l’Homme au Mali : Amnesty International dépeint un tableau sombre dans son rapport 2020
mercredi 8 avril 2020, par
« La situation sur le plan de la sécurité s’est fortement dégradée dans le centre du pays, notamment en raison de violences intercommunautaires. Les groupes armés et les forces de sécurité ont continué de commettre des atteintes aux droits humains. L’impunité persistait pour les crimes les plus graves. L’insécurité s’est traduite par de très fortes entraves au droit à l’éducation. L’interdiction des rassemblements pacifiques a été maintenue dans le centre-ville de Bamako ». C’est en ces termes qu’Amnesty international résumé la situation du Mali dans son rapport publié le 8 avril 2020.
Dans son rapport, Amnesty International n’est pas allé avec le dos de la cuillère en ce qui concerne la situation du Mali. « Les atteintes aux droits humains se sont poursuivies dans la région de Mopti, en particulier avec la multiplication d’homicides perpétrés massivement contre des civils par des groupes armés et des « groupes d’autodéfense » autoproclamés », indique Amnesty dans son rapport. Avant de préciser que « des exécutions extrajudiciaires et des actes de torture commis par l’armée ont aussi été signalés par l’ONU ». Et, pire l’organisation internationale de défense des droits de l’homme a rappelé qu’ « À la fin de l’année, plus de 200 000 personnes avaient été déplacées à l’intérieur du pays, d’après les chiffres de l’ONU (leur nombre avoisinait les 120 000 en janvier 2019) ».
Dans la synthèse du rapport, Amnesty International a rappelé qu’en décembre, l’expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Mali a déclaré : « La situation sécuritaire au Mali a maintenant atteint un niveau critique, avec une présence limitée des institutions de l’État dans certaines régions, des violences sur fond de tensions communautaires et des attaques terroristes de plus en plus meurtrières contre les forces de sécurité, ainsi que les civils. »
C’est dans ce contexte que le mandat de la Commission d’enquête internationale pour le Mali [ONU], établie le 19 janvier 2018, a été prolongé jusqu’au 19 juin 2020. « Cette commission avait pour mission d’enquêter sur les allégations d’abus et de violations du droit international relatif aux droits humains et du droit international humanitaire commis entre le 1er janvier 2012 et la date de sa création », a indiqué Amnesty International.
Exactions perpétrées par des groupes armés
« Les groupes armés ont continué de s’en prendre à la population civile et, selon les statistiques de l’ONU, au moins 450 civil•e•s ont été tués en 2019, dont plus de 150 enfants durant les six premiers mois de l’année », indique la synthèse du rapport. Avant d’ajouter que « toujours d’après l’ONU, au cours de ce premier semestre, au moins 250 personnes civiles ont ainsi été tuées dans la région de Mopti. Entre le 1er octobre et le 30 décembre, 200 civil•e•s ont été tués, 96 blessés, et 90 enlevés. Durant cette même période, plus de 85 % des attaques meurtrières visant la population civile ont eu lieu dans la région de Mopti ».
Citant l’ONU, le rapport indique que « le 1er janvier 2019, dans la région de Mopti, 37 personnes ont été tuées dans le village peul de Koulogon-Peul. Le 23 mars, au moins 150 hommes, femmes et enfants ont été tués lors d’une attaque menée contre le village d’Ogossagou. Trente-cinq personnes, dont 22 enfants de moins de 12 ans, ont été tuées le 9 juin au cours d’une attaque contre le village dogon de Sobane-Da. Huit jours plus tard, au moins 38 personnes ont été tuées lors d’une offensive menée contre deux villages (Gangafani et Yoro) dans le cercle de Koro, selon les autorités. Le 13 novembre, des soldats maliens ont découvert 20 cadavres dans le village de Peh ; certains de ces corps avaient été jetés dans des puits ».
Le rapport a aussi indiqué que « des groupes armés ont également pris pour cible des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des griots ». Amnesty International a précisé que « des médias ont signalé de façon concordante que, le 17 avril, le chef du village de Pissa, dans le cercle de Bankass, avait été tué par des hommes armés non identifiés. Le 22 juin, le chef du village de Hombori, Nouhoum Bah Maiga, a été tué par des hommes armés non identifiés et, le 19 juillet, à Dialloubé, un célèbre griot, Modi Djignandé, plus connu sous le nom de « Niappa », a lui aussi été tué par des inconnus armés ».
Exécutions extrajudiciaires
Au titre des exécutions extrajudiciaires, Amnesty International a indiqué « les Forces de défense et de sécurité maliennes se sont également rendues coupables de violations des droits humains ». L’association de défense des droits de l’homme a rappelé que « l’ONU a rassemblé des informations sur 17 exécutions extrajudiciaires perpétrées par ces forces dans plusieurs régions, notamment à Intahaka (région de Gao) et à Mondoro (région de Mopti) ». Avant d’ajouter qu’elles ont également été responsables d’au moins quatre cas de torture et d’autres mauvais traitements.
Justice
Dans le volet de la justice, Amnesty International a invité les autorités maliennes à lutter contre l’impunité. A ce titre, l’Association de défense des droits de l’homme a rappelé que le 24 juillet, le président Ibrahim Boubacar Keïta a promulgué une loi « d’entente nationale », qui exemptait de poursuites les personnes ayant commis des crimes dans le cadre des évènements liés à la « crise née en 2012 » ou en ayant été complices. Malgré le fait que le champ d’application de cette loi excluait les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le viol et les crimes imprescriptibles, Amnesty International n’a pas manqué de rappeler que l’expert indépendant des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Mali a invité les autorités à réviser cette loi « de manière à ne pas empêcher les victimes de violations graves d’exercer leur droit à un recours effectif devant un tribunal ou tout autre mécanisme de justice transitionnelle pour une justice juste et équitable, d’obtenir réparation et de connaître la vérité sur les violations commises dans le passé ».
Dans sa synthèse Amnesty International a indiqué que « le même jour, le président Ibrahim Boubacar Keïta a également promulgué une loi élargissant le champ de compétence du Pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, pour y inclure le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité ».
« Malgré le très grand nombre d’atteintes aux droits humains commises depuis 2012, peu de procès ont eu lieu, et les condamnations ont été encore plus rares. Les procédures judiciaires engagées en 2014 et 2015 contre des membres de groupes armés pour des violences sexuelles en étaient toujours au stade de l’enquête. Le procès du général Amadou Haya Sanogo et d’autres personnes, qui avait été suspendu en décembre 2016, n’avait toujours pas repris. L’inculpation du général était en lien avec l’enlèvement et l’exécution extrajudiciaire de 21 soldats », indique la synthèse du rapport.
Justice internationale
Si du côté du Mali, les procès sont en train de piétiner, tel n’est pas le cas au niveau de la justice internationale. « Le 30 septembre, la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé les charges de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, y compris de torture, de viol, de mariage forcé et d’esclavage sexuel, portées à l’encontre d’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (dit « Al Hassan ») », a rappelé Amnesty International. Avant d’ajouter que « ce membre d’Ansar Eddine, qui aurait été commissaire de facto de la Police islamique à Tombouctou au moment de la commission des crimes présumés, était la deuxième personne poursuivie devant la CPI pour des motifs liés à la situation au Mali ».
Liberté de réunion
Amnesty International de façon subtile a fait remarquer que la liberté de réunion pose problème au Mali. Selon l’organisation de défense des droits de l’homme, « une manifestation a été organisée à Bamako le 5 avril à l’appel de dirigeants religieux, alors que le gouvernement l’avait interdite ». Elle a rappelé qu’ « une interdiction générale des manifestations dans le centre-ville de Bamako avait été décrétée à la suite de l’attaque de novembre 2015 contre l’hôtel Radisson Blu de la ville. Cette interdiction a été reconduite, en octobre, pour une année supplémentaire ».
Droit à l’éducation
En ce qui concerne le droit à l’éducation, Amnesty International, sans le dire directement, soutient que le Mali n’est pas le bon exemple. « Depuis le début du conflit, 1 051 écoles ont dû fermer (chiffre relevé en octobre 2019) en raison de l’insécurité et des menaces qui ont conduit les enseignant•e•s à quitter leurs postes ; 315 300 enfants étaient concernés », a regretté Amnesty International dans son rapport. Avant d’indiquer que « les établissements scolaires et le personnel enseignant ont continué d’être visés par des groupes armés ». Le rapport a précisé qu’ « en octobre, des médias locaux ont signalé que, dans la région de Tombouctou, plusieurs écoles avaient été attaquées par des groupes armés. À la fin du mois d’octobre, le gouvernement a annoncé que cinq enseignants avaient été enlevés le 25 octobre à Korientzé (cercle de Mopti) et relâchés quelques jours plus tard ».
Assane Koné
Voir en ligne : Droits de l’Homme au Mali : Amnesty International dépeint un tableau sombre dans son rapport 2020