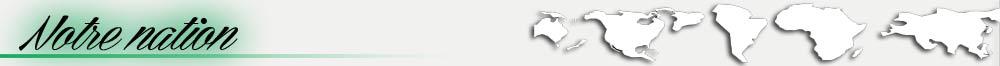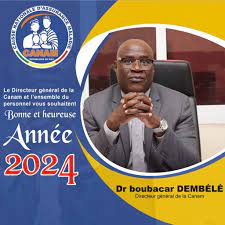Culture > Semaine de la fraternité de l’AES : Un Colloque explore les enjeux et les perspectives de la construction d’un Etat (…)

Semaine de la fraternité de l’AES : Un Colloque explore les enjeux et les perspectives de la construction d’un Etat confédéral au Sahel
vendredi 14 février 2025, par
Dans le cadre de la 21e édition de Ségou’Art/Festival sur le Niger, l’organisation d’une
Table ronde sur le thème de « La construction d’un état confédéral au Sahel : Enjeux et perspectives », a retenu toutes les attentions. Cependant, au moment où l’on s’attendait à ce que ce thème soit abordé sur tous les aspects de la vie, le profil des panélistes les a sûrement poussés à circonscrire le thème dans le champ de la culture, en tentant de pousser la réflexion sur le rôle et la place de la culture dans la construction d’un état confédéral comme l’AES.
Maki Garba, directeur général de l’Agence de Promotion des Entreprises et Industries culturelles du Niger, a mis un accent sur l’importance de l’enjeu de la culture. « Elle peut nous aider à rapprocher nos peuples dans des activités culturelles tournantes », a-t-il indiqué. Pour cela, il a suggéré d’aller rapidement à l’harmonisation des initiatives culturelles dans nos différents états. Aussi, il a proposé de mettre en place un dispositif comme pour rehausser le niveau d’éducation dans la zone d’AES, sans oublier la prise en charge urgente du renforcement de la stratégie de la fluidification des échanges des hommes et des biens entre les territoires. Et, songer à l’installation d’unités de transformation de nos matières premières dans notre zone.
Partant du postulat que tout construction humaine a commencé par la culture, Dr Fodé Moussa Sidibé a proposé aux trois états d’axer leurs efforts sur la culture pour bâtir ce nouvel ensemble qui pourrait émerveiller le monde tant ses potentialités sont énormes. « Il va falloir mettre à contribution la culture pour la construction de l’AES », a-t-il déclaré. Pour ce faire, il a fait un certain nombre de propositions. Il a proposé d’identifier dans chaque pays des manifestations emblématiques et mettre en place un dispositif qui permet d’associer les autres pays de l’AES de façon significative.
Après avoir rappelé que les trois pays de l’AES ont en partage la pratique de la confrérie des chasseurs traditionnels, Dr Fodé Moussa Sidibé a proposé de reprendre la manifestation des chasseurs traditionnels qui fédérait toutes les communautés de chasseurs de l’Afrique de l’ouest au Mali.
Pour l’inscription sur la liste du patrimoine mondial, il pense qu’il ne sert plus à rien que les trois pays aillent en rang dispersé. Il pense qu’il va falloir travailler pour aller avec une liste commune à l’AES. Comme l’intervenant du Niger, il va proposer d’initier et de mettre en œuvre des manifestations à l’échelle AES pour une mobilisation de nos peuples.
« La politique culturelle d’une confédération d’États doit permettre de dépasser les fractures historiques pour créer une dynamique d’unité sans nier la diversité »
Pour sa part, Dr Hamadou Mandé, Maître de conférences à l’université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, au Burkina Faso, a indiqué que si l’on veut faire de la culture le socle de la construction de l’état fédéral, qu’il va falloir travailler à l’adoption d’une politique culturelle commune. « Comment faire de la culture un socle pour la construction de l’État fédéral en Afrique ? », est la question centrale qui va soutenir sa réflexion.
A cet effet, il a rappelé que « L’unité dans la diversité », a été le thème du 5e Sommet des Institutions Culturelles d’Afrique et de la Diaspora (SICADIA) tenu à Yaoundé au Cameroun en 2017. Selon lui, à la question de « Comment construire l’unité dans la diversité ? », une des réponses était de « travailler à capitaliser les acquis et les leçons de notre longue histoire ainsi que ceux du présent, pour élaborer et mettre en œuvre des politiques culturelles capables de répondre efficacement aux enjeux de développement de nos sociétés (Défense, Diplomatie et Développement/ Éducation, Santé, Environnement, etc.) »
Dans cette perspective, il dira que « la politique culturelle d’une confédération d’États doit permettre de dépasser les fractures historiques pour créer une dynamique d’unité sans nier la diversité ».
Convaincu de cela, il dira que la mise en place d’une politique culturelle dans une confédération repose sur un équilibre délicat entre respect des identités locales et construction d’un cadre commun. « Les États membres doivent coopérer tout en conservant leur souveraineté », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que cela nécessite de relever un certain nombre de défis. Ce sont : Construire une identité collective sans effacer les identités locales ; Mettre en réseau des institutions culturelles des États membre ; Faire de la culture un levier économique et diplomatique en développant une diplomatie culturelle confédérale ; Développer l’économie de la culture pour en faire un moteur de développement en investissant massivement dans les industries culturelles et créatives ; Éduquer les générations futures à l’histoire et aux valeurs de la confédération en veillant à réviser les programmes scolaires pour prendre en compte les fonds historiques communs et les réalités partagée ; Harmoniser les institutions, les lois et les priorités culturelles, y compris les politiques linguistiques et les mécanismes de traduction.
« La politique confédérale n’est pas la somme ou la synthèse des politiques nationales »
A ce effet, il a estimé que « la politique confédérale n’est pas la somme ou la synthèse des politiques nationales, mais plutôt la résultante d’une vision globale traduite en orientations stratégiques et servant de référentiel pour les États-membres ». Et, d’ajouter que « pour que la culture serve véritablement de socle à la construction d’une collectivité, d’une nation ou d’une communauté d’États, il faut travailler à déconstruire les idées reçues sur la culture et la politique culturelle, à décoloniser les esprits ». Selon lui, il s’agira d’abandonner les habitudes des politiques culturelles nationales cloisonnées dans les limites d’un secteur ministériel, pour adopter une approche de politiques plus inclusives, plus participatives et véritablement transversales.
Il a même fait une tentative de propositions des conditions de réussite de la politique culturelle confédérale. Ce sont : une volonté et un engagement politique ; un ancrage culturel local ; le décloisonnement des actions ; la participation de toutes les composantes de la société dans une logique de synergie d’actions ; la conscience de la valeur et de la dimension de la culture elle-même ; la transversalité ; une communication de qualité ; la valorisation des ressources endogènes ; un investissement financier massif, etc.
Il a conclu son intervention par une information capitale. Selon lui, « dans le but d’apporter sa contribution aux collectivités, aux États et aux communautés d’États désireux de se doter de politiques culturelles pertinentes, l’Observatoire des politiques culturelles en Afrique (OCPA) a publié en 2007 un Guide pour l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques culturelles en Afrique ». Il a précisé que ce guide révisé en 2015 et a été mis à jour en 2024 (version actualisée validée durant le SICADIA 7 de Conakry et en cours d’édition). « La politique culturelle confédérale de l’AES devrait s’inscrire dans une perspective panafricaine », a-t-il suggéré pour terminer.
« Documenter l’héritage culturel », est la proposition de Dr Daouda Coulibaly du Niger. Il a aussi proposé de rapidement travailler au développement d’un curriculum commun d’éducation, sans oublier la valorisation et la promotion de nos langues nationales. Il pense qu’il est aussi urgent d’avoir un Fonds AES de développement de la culture, pour faire la promotion de notre diversité culturelle. Il se refuse d’admettre que « la diversité, considérée comme une richesse ailleurs, soit aujourd’hui perçue une malédiction chez nous ».
« Venu en toute humilité pour comprendre, je n’avais la prétention de diriger la séance ». C’est par cette phrase que Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali a introduit ses propos à cette table ronde. Selon lui, au regard du schéma dicté par le contexte géopolitique, on ne peut pas se contenter de tourner la page. « Il faut sortir du livre », a-t-il proposé.
Il a ajouté que nos Chefs d’état ont la vision et la volonté, mais, il faut qu’on les accompagne. Il a regretté le fait que « les africains ont des combats éphémères, alors que nos adversaires conduisent des combats dans la durée ». « De la colonisation à aujourd’hui, jusqu’à demain, ils poursuivent les objectifs », a-t-il déclaré.
Et, comme il est convaincu qu’on ne peut pas faire un combat à long terme avec la politique, qu’il va falloir explorer la culture qui semble nous donner des pistes, d’où cet enjeu important autour de la culture pour ce combat.
Abdoulaye Diop a proposé de travailler à la décolonisation des esprits. Il a même rappelé le syndrome du persécuté. « Quelqu’un qu’on a persécuté, à 90%, cette personne va persécuter », a-t-il indiqué. Avant de se poser la question suivante : « Pourquoi ceux qui disent qu’on est pauvre, quand ils sont chez nous, ils ne veulent plus partir ? ». Dans tous les cas, Abdoulaye Diop est convaincu que « la colonisation mentale a créé le doute chez nous et chez nos intellectuelles ». Il a rappelé la phrase célèbre de Nelson Mandela, selon laquelle : « C’est toujours impossible jusqu’à ce que quelqu’un le fasse ». Il pense qu’il est tout à fait normal et logique de « sortir de schémas des institutions détachées de nos réalités ». Et, de dire sa conviction selon laquelle, « On ne peut pas faire l’intégration des peuples, sans un changement de paradigme ».
Depuis le 29 janvier 2025, trois états du Sahel précédemment membres de la CEDEAO, ont acté leur départ de cette organisation sous-région. Désormais regroupés dans la Confédération de l’Alliance des états du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de prendre leurs destinées en main. Et, c’est dans ce contexte que du 3 au 9 février 2025, la ville de Ségou a abrité les activités de la Semaine de la fraternité de l’AES.
Assane Koné
Voir en ligne : Semaine de la fraternité de l’AES : Un Colloque explore les enjeux et les perspectives de la construction d’un Etat confédéral au Sahel