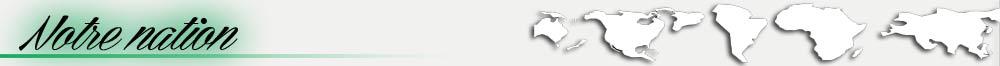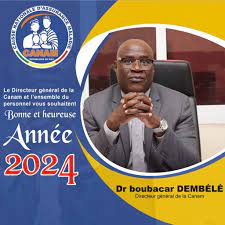Culture > De l’urgence d’un plan « Maroc Culture »

De l’urgence d’un plan « Maroc Culture »
lundi 29 juillet 2019, par
Un secteur qui souffre d’un manque de volonté politique. L’industrie du divertissement emploie 1 million de personnes au Nigeria. La culture contribue 7 fois plus au PIB que l’industrie automobile en France. L’année 2018 a connu la production de 111 courts-métrages, 3 moyens-métrages, 35 séries télévisées, 18 téléfilms, 163 spots publicitaires, 22 docu-fictions et 7 sitcoms. Par ailleurs 17 longs-métrages ont été tournés au Maroc avec un budget de plus de 322 MDH.
Si certains pays, du nord comme du sud ont compris depuis les années 90, l’impact de la culture dans la création d’un modèle de développement économique et social moderne, nos gouvernements successifs ne semblent toujours pas convaincus du potentiel de ce secteur à produire de la richesse et de l’emploi à travers la création et l’exploitation de la propriété intellectuelle. Pourtant les recommandations des nations unies sont claires. Particulièrement celles de l’Unesco, qui démontrent que l’économie créative, qui comprend les produits audiovisuels, le design, les nouveaux médias, les arts du spectacle, l’édition et les arts visuels, est un des secteurs connaissant la croissance la plus rapide de l’économie mondiale. Selon l’institution, le commerce mondial de biens et services créatifs a atteint un niveau record de 624 milliards de dollars en 2011. Il a plus que doublé entre 2002 à 2011 augmentant chaque année en moyenne de 12,1% dans les pays en développement. En France la culture contribue 7 fois plus au PIB que l’industrie automobile avec 57,8 milliards d’euros de valeur ajoutée par an (3,2% du PIB) . Son coût total pour la collectivité approche les 21,5 milliards d’euros (chiffres 2014). Au Nigeria, première puissance culturelle en Afrique, l’industrie cinématographique génère plus de 600 millions de dollars américains, « Nollywood », est la deuxième industrie cinématographique mondiale en terme de volume. Ses industries de la musique et de la mode sont au premier rang des exportations culturelles du pays. En 2017 l’industrie du divertissement et des médias a employé plus d’un million de personnes et a généré plus de 7 milliards de dollars pour l’économie nationale.
Pour chaque dirham engagé, 17 DH générés pour la ville
Plus près de nous et donc beaucoup plus significatif, le cas de la ville d’Essaouira est le plus parlant. Selon une étude menée par la Fondation Valyans (toujours en 2014) sur les retombées économiques générées par le festival Gnaoua et musiques du monde au profit de la ville, pour chaque dirham investi, le festival en a généré 17 pour la cité des Alizés. Les budgets cumulés du festival ont atteint 100 millions de DH en 16 éditions, ce qui équivaut à 1,7 milliard de DH pour la ville. Plus encore, la capacité litière a été multipliée par 4,7 fois et le nombre de nuitées par 3,3 fois en 16 ans. Malgré tous ces indicateurs, et bien que l’enveloppe du ministère de la Culture est passée de 593 millions de DH en 2012 à 711 millions de DH en 2016, le budget alloué au département, oscille toujours, bon an mal an, entre 0,25% et 0,30% du budget général de l’Etat (contre 0,53% en Algérie et 0,71% en Tunisie). « Le secteur de la culture souffre d’un manque de volonté politique, d’un faible budget essentiellement consacré aux dépenses de fonctionnement, donc d’un réel problème de financement.

Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la mise à niveau de l’Économie du Maroc
La grande majorité des entreprises créatives se concentrent dans l’axe Rabat/Casablanca, alors qu’un grand nombre de régions ne dispose d’aucune structure du genre
Le département de l’économie et des finances, en raison de ses attributions décide des budgets aux différents départements, et se trouve en amont des dépenses relatives au patrimoine culturel. C’est donc un intervenant déterminant à rallier », selon le document intitulé « La culture, donner du sens au développement », publié en février 2018, à l’occasion de la création de la fédération des industries culturelles et créatives au sein de la CGEM (FICC). Cette dernière, présidée par Neila Tazi, fondatrice du festival Gnaoua et musiques du monde et membre de la chambre des conseillers, a d’ailleurs signé une convention de partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication. Principaux axes : Le renforcement du partenariat public-privé, le climat des affaires et l’investissement, sur les volets formation, dynamique régionale, les droits d’auteurs, et enfin l’organisation en partenariat entre le ministère et la FICC des Assises de la Culture. Car comme le précise la présidente de la FICC : « Les moyens financiers sont indispensables mais ce qu’il faut avant tout c’est une vision commune, une mise en synergie pour susciter une nouvelle dynamique » (voir interview page 6). Une vision que le Conseil économique, social et environnemental (CESE) avait développé dans son rapport sur l’économie de la culture publié en 2016. Il s’était en effet autosaisi du sujet. Son avis, adopté le 30 juin 2016, dresse une liste des mesures à mettre en place pour engager une dynamique économique où la culture occuperait la place sociétale, éducative, civilisationnelle nécessaire pour la renaissance du Maroc. Le rapport pointe du doigt l’insuffisance des allocations de fonds publics ou privés, ainsi que l’absence de prise de risque dans le cadre du soutien présenté aux entreprises culturelles tout autant que le soutien alloué à des activités éphémères, au lieu d’être destiné à des institutions pouvant garantir la continuité des manifestations. Mais le rapport met l’accent également sur l’absence de coordination entre les acteurs officiels chargés des activités et domaines culturels ainsi que la concentration des activités des entreprises dans deux domaines seulement, à savoir le cinéma et l’audiovisuel.
Une agence pour la culture et un fonds public-privé pour le financement
De ce fait le CESE recommande notamment la mise en place d’une Agence de la Culture et d’un « fonds public et privé de financement multi-sources, afin de soutenir les efforts de financement déployés pour la réussite des mécanismes permettant l’intégration des jeunes par la culture ». Il préconise, en outre, l’instauration de partenariats qui auraient pour tâche de financer la création d’instituts de formation dans le domaine des beaux-arts, de promouvoir l’exploitation des salles disponibles pour la culture (cafés, centres…), proposer des chèques lecture pour motiver les jeunes… Des recommandations, restées, jusque là, lettre morte, comme bon nombre d’autres tentatives de faire de ce secteur une locomotive de développement.
Pour rappel, il était question en 2014 de créer une Société de développement des entreprises culturelles, entre le ministère et le GPBM, projet qui n’a jamais vu le jour. Cette société devait être un guichet unique pour administrer des aides publiques provenant de divers départements, escompter des subventions, autoriser des prêts grâce à un partenariat avec des banques.
La culture ne doit pas être considérée comme un bénéficiaire collatéral

Malgré une augmentation remarquable du nombre d’emplois déclarés dans le secteur, le CESE note l’instabilité de l’emploi dans les métiers artistiques et culturels et du risque de perte de revenus chez les professionnels du secteur.
Par ailleurs le département de Mohamed Laarej, tente tant bien que mal de poursuivre ses stratégies « Maroc Culturel 2020 » et « Patrimoine 2020 » visant plus de soutien financier aux productions et associations culturelles, la proximité territoriale, la conservation du patrimoine culturel et artistique, le développement de la bonne gouvernance, et plus d’infrastructures culturelles pour les collectivités locales. Cependant, et comme le précise le CESE, la culture est un domaine transversal dont la prise en charge nécessite une action plurielle et un partage des rôles entre les différents départements ministériels avec une définition claire des responsabilités et une solide mise en cohérence. Dans un monde où les économies sont essentiellement basées sur le savoir, le patrimoine culturel n’est plus regardé uniquement dans sa dimension culturelle et civilisationnelle, mais aussi comme un outil initiateur de développement. Cette reconnaissance doit s’accompagner désormais d’une meilleure appréhension statistique des effets économiques directs et indirects du patrimoine culturel et des industries créatives. En un mot, comme le souligne le CESE la culture ne doit plus être considérée comme « un bénéficiaire collatéral d’autres programmes de développement sectoriels » mais plutôt comme un axe prioritaire. Une recommandation dont la FICC compte bien faire son cheval de bataille. Rendez-vous donc aux prochaines Assises.
Tristes chiffres
Des statistiques du Haut Commissariat au plan (HCP) il ressort que dans le temps dépensé en pratiques culturelles, le citoyen marocain :
• passe en moyenne 2h14 par jour devant la télévision
• consacre moins de 2 minutes par jour à la lecture
• 76% des jeunes entre 18 et 24 ans ne pratiquent jamais d’activité artistique
• Seuls 12.000 élèves sont inscrits annuellement dans les 53 conservatoires du Maroc (publics et privés)
• 2 millions de personnes par an visitent les monuments et les sites historiques du Maroc. A titre de comparaison, l’Alhambra de Grenade à elle seule accueille près de 2,5 millions de visiteurs par an et la ville de Paris totalise 69 millions d’entrées par an.
• Les recettes des monuments et sites historiques sont de 16 millions de DH annuellement en moyenne.
• Il existe 80 musées à travers le territoire dont 14 relevant de la Fondation nationale des musées et 66 d’entités publiques et privées.
• En 2015 il y avait 57 écrans de cinéma à travers le Maroc qui généraient 74 millions de DH de recettes (350 salles dans les années 70).
• Le Maroc édite environ 2000 livres par an (tous domaines et champs confondus)
• Le pays compte un déficit de 4000 bibliothèques (estimations UNESCO)
• La plupart des entreprises culturelles travaillent dans le secteur du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle. 90% de ces entreprises comptent sur leurs propres moyens.
Par Amine BOUSHABA
Voir en ligne : De l’urgence d’un plan « Maroc Culture »