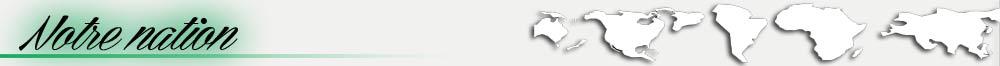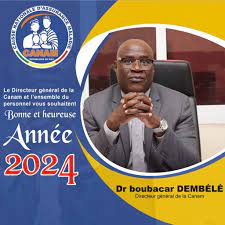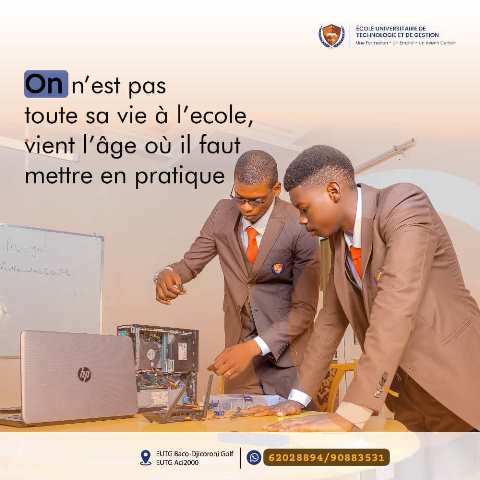Environnement > Kéniéba : Attention la Falémé se meurt à cause de l’orpaillage

Kéniéba : Attention la Falémé se meurt à cause de l’orpaillage
jeudi 17 mai 2018, par
"Deux phénomènes inquiétants menacent la Falémé et ses affluents. Ce sont d’une part l’obstruction, l’envasement et la déviation des cours d’eau dus à l’érosion des berges, le drainage des boues des cracheurs et les rejets des dragues et d’autre part la pollution des cours d’eau conséquence de l’utilisation de produits chimiques, des huiles de vidange, carburant et autres liquides utilisés pour le fonctionnement ou l’entretien des machines". C’est en substance la conclusion d’une étude sur les différentes sources de pollution de la Falémé et de ses affluents dans les communes de Dabia, Faléa, Faraba et Kéniéba dans le cercle de Kéniéba.
Dans le cadre de son « Projet de Renforcement des capacités des acteurs locaux de la Commune Rurale de Faléa et du Cercle de Keniéba dans la gouvernance du secteur minier », financé et soutenu par la Fondation Rosa Luxemburg (FRL-WA), Action Solidarité pour les 21 villages de la Commune Rurale de Faléa (ASFA 21), a initié l’ étude sur les différentes sources de pollution de la Falémé et de ses affluents dans les communes de Dabia, Faléa, Faraba et Kéniéba dans le cercle de Kéniéba. Le Jeudi 10 mai 2018, dans les locaux de ASFA 21 à Doumanzana, le consultant Guimba Diallo a levé un coin du voile sur les résultats de cette étude.
Nouhoum Keita, Coordonnateur des activités de ASFA 21, a indiqué que l’objectif global de cette étude vise à évaluer l’état des lieux, faire le suivi environnemental, de la pollution et de la destruction de l’affluent le plus important du fleuve Sénégal, qui est la Falémé dans le Cercle de Kénieba.
De façon spécifique, il a estimé que cette étude aidera à établir une carte d’occupation des sols dans le cercle de Kénieba ; à identifier les différentes sources d’impacts de pollution sur la rivière Falémé et ses affluents ; à identifier des points de prélèvement pour l’échantillonnage des eaux sur la Falémé et ses confluents ; à procéder à l’analyse physico-chimique des eaux prélevées ; à proposer les meilleures stratégies éco-actions idoines permettant d’assurer le développement durable de tous les espaces qui jalonnent la Falémé dans le Cercle de Kéniéba.

Dans le chapitre des « sources et processus de pollution de la Falémé et des ses affluents », Guimba Diallo a cité : l’orpaillage et l’utilisation de produits chimiques.
Méthodes dégradantes pour l’environnement et polluantes pour la Falémé
Selon lui, l’orpaillage considéré comme une activité traditionnelle et culturelle dans le Cercle de Kéniéba, constitue la principale occupation et source de revenu des populations. « On dit que bientôt dans chaque village, il y aura au moins un placer », a-t-il indiqué pour illustrer l’ampleur de l’activité. Cependant, il a estimé que différentes activités liées à l’orpaillage contribuent à la dégradation et à la pollution du fleuve Falémé. Ce sont : L’extraction et le lavage du minerai.
« Toutes les méthodes utilisées actuellement sur le terrain pour l’orpaillage sont dégradantes en général pour l’environnement et polluantes en particulier pour la rivière Falémé », a-t-il déclaré. Avant de lever le voile sur les différentes étapes dans le processus d’exploitation de l’or qui mettent dangereusement l’environnement en cause : La déforestation/déboisement, l’usage des Cracheurs, la mise à contribution des Pelles mécaniques et l’utilisation des Dragues.
« Les techniques de l’orpaillage utilisées présentent des risques et des dangers pour l’environnement physique et se traduisent tout d’abord par des déboisements, la destruction du couvert végétal et la dégradation des sols en vue de l’installation des habitats des exploitants et des lieux d’implantation des placers », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter que les fortes concentrations de centaines, voire de milliers d’orpailleurs sur le même site (plateau, glacis, ou berge de la rivière), s’accompagnent toujours d’une coupe abusive de bois pour faire face aux besoins des mines, des habitations et de bois de chauffage. « Les arbres sont coupés et les troncs utilisés pour étayer les galeries souterraines et renforcer les parois », a-t-il ajouté.
Et, pour mettre un accent particulier sur le phénomène, il dira que « Cette coupe de bois est tellement importante qu’il est dit que dans le cercle, qu’il y aurait beaucoup plus de bois sous la terre dans les mines que d’arbres vivants sur la terre ».
Chose grave, il dira que « la destruction des végétaux se trouve renforcée aussi par la recherche de pépites qui sont réputées se trouver entre les racines de certaines plantes ». Conséquence : La dégradation des galeries forestières et des terres qui sont alors rendues impropres à l’agriculture.
Le consultant a estimé que dans le sillage des fréquents déplacements des orpailleurs vers d’autres sites plus riches, des centaines de puits et d’ouvrages miniers sont parfois abandonnés, et exposent ainsi le sol au processus d’érosion intensive, aboutissant à une destruction totale du sol superficiel. « Ces chantiers ‘’orphelins’’ représentent un réel danger pour la circulation des hommes et des animaux. Les anciens sites, généralement abandonnés sans aucune protection, sont jalonnés d’excavations parfois très profondes (jusqu’à 50 ou 60 m) souvent camouflées par les eaux stagnantes ou la végétation secondaire », a-t-il indiqué. Avant dénoncer le fait que les réserves de terres souvent très fertiles du domaine forestier protégé sont donc directement touchées par l’exploitation minière qui les dégrade au détriment de l’agriculture. « Ces processus sont quasiment irréversibles et peuvent devenir catastrophiques à l’échelle de quelques générations », a-t-il conclu sur cet aspect.
Près de 1000 Cracheurs en activité
Après avoir rappelé qu’au Mali, l’or ne se trouve pas toujours sous forme de pépite, mais aggloméré aux roches (généralement du quartz), le consultant dira que cette particularité géologique nécessite plusieurs procédés fastidieux et polluants pour dissocier l’or de la pierre.
Dans une description du travail, il dira que les orpailleurs sont d’abord contraints de réduire les roches en poussière par un concassage manuel (fréquemment effectué par les femmes ou les enfants) puis un broyage à l’aide d’une machine, rarement adaptée à cette activité puisqu’il s’agit souvent de moulins à farine classiques.

« Cette farine de roche est ensuite lavée aux abords des cours d’eau à l’aide de pompes installées dans les cours d’eau qui alimentent le fleuve Falémé. Pendant la saison hivernale la boue est drainée vers le lit majeur de la rivière », a-t-il précisé. Avant de dire qu’il y a près d’un millier de cracheurs/concasseurs dans la zone d’étude selon le Président de la Chambre des Mines de Kénieba.
Les Pelles mécaniques favorisent la sédimentation accélérée du lit du fleuve
Selon le consultant, l’utilisation des pelles mécaniques, est une nouvelle méthode d’orpaillage mécanisé qui a été observée en début d’année 2018. Il le dit sur la base des déclarations du Chef du service local de l’Assainissement. Selon lui, cette méthode fait appel à une pelle mécanique (des fois à chenilles) qui charge des camions dont les contenus seront traités dans ou aux abords des cours d’eau. « Là encore c’est la sédimentation et l’obstruction du lit qui se fait de manière plus accélérée », a déclaré le consultant, qui cite le village de Mamoudouya comme un exemple de pollution et de dégradation des sols dus à cette pratique.
Plus de 600 dragues dans la seule commune de keniéba
« Le dragage est aussi une technique récente d’orpaillage mécanisé (moins de 10 ans) qui consiste à extraire l’or contenu dans le sable, le gravier et le sol des cours d’eau », a indiqué le consultant. Selon lui, le concept est basé sur le fait que l’or contenu dans le sable, le gravier ou le sol se dépose au fond des lits des cours d’eau et peut être récupéré sous forme de grains ou de paillettes par simple lavage mécanique.
« C’est pourquoi les dagues en général et celles à godets (connues sous le nom de drague chinoises) en particulier rejettent d’énormes quantités de matériaux constituant des monticules et des ilots dans le lit des cours d’eau après traitement », a-t-il expliqué.
Ce fléau est d’autant plus inquiétant qu’on fait face aujourd’hui à une prolifération des dragues (qui coutaient plus de 10 millions contre 2 millions actuellement). Il a estimé qu’on peut compter environ 600 dragues dans la seule commune de Kenieba. Précis, il dira le Chef de service de l’Assainissement dans la localité affirme avoir compté une fois au cours de ses déplacements 63 dragues sur une distance de 530 m.
« La création des turbidités et la contamination des eaux par les boues entraînent la destruction des frayères et un appauvrissement de la faune aquatique limitant ainsi les productions halieutiques », a-t-il regretté.
Pour mettre l’accent sur la gravité du phénomène, il dira que la turbidité et la pollution de l’eau sont telles que le village de Moussala a renoncé à l’utilisation de l’eau de la Falémé pour faire le maraichage. Pire, il dira que les digues construites de part et d’autre de l’immense drague à godets des chinois dans le village de Kimo risque de dévier la rivière de son cours normal. « D’après un habitant du village, ils seraient menacés d’inondation », a-t-il rappelé.
L’utilisation des produits chimiques toxiques pour l’organisme
« Le lavage à l’eau simple ne permettant de récupérer que des pépites et grains d’or ; le reste de la boue est traitée à l’aide de cyanure (cyanuration) ou de mercure (amalgamation) pour en extraire de l’or plus fin », a estimé le consultant. Avant de dire que les deux procédés sont dangereux du fait de leur toxicité pour l’organisme.

Selon le consultant, le lavage et le traitement aux produits chimiques se font manuellement avec des calebasses ou des tables en bois par les orpailleurs traditionnels qui ne sont plus considérés comme tels dès qu’ils utilisent ces produits chimiques (ce qui est toujours le cas maintenant).
Le consultant a indiqué que la technique par amalgamation dégage des vapeurs qui sont dangereux pour les organes vitaux (système nerveux central, poumons et reins de ceux qui les respirent). Selon lui, ces fumées empoisonnent les orpailleurs mais aussi leurs familles vivant à proximité des lieux de travail.
Plus grave, il dira que le mercure et le cyanure ne sont pas les seuls produits utilisés. Selon lui, on y retrouve des acides sulfuriques ou nitriques, du zinc, des huiles de moteur usagées et des détergents.
« D’autres exploitants ‘’spécialistes’’ de produits chimiques (non Maliens venant de la sous-région le plus souvent) rachètent les boues traitées par les orpailleurs maliens et les transportent un peu plus en hauteur pour un deuxième traitement au mercure au cyanure et à d’autres produits chimiques », a indiqué le consultant. Avant de dire que ce traitement se fait dans des trous creusés à cet effet entre 2h et 5h du matin, moment choisi à cause de l’odeur suffocante que cette opération dégage. « Il est heureux de constater que quelques rares Chefs de village comme celui de Siribaya s’opposent énergiquement à ces pratiques », a-t-il fait remarquer.
Cependant, l’étude a indiqué qu’il reste regrettable que l’ensemble de ces différents produits, notamment les résidus de cyanure sont déposés ou drainés vers le lit de la Falémé et de ses affluents.
« Ces différents composés s’infiltrent dans les sols, polluent et intoxiquent le bétail, dégradant les conditions de vie et de travail déjà précaires des agriculteurs et éleveurs des régions concernées. Les habitants vivant à proximité des mines sont aussi touchés par la pollution des eaux (nappes phréatiques et rivières contaminées) », a-t-il indiqué.
Il a aussi énuméré d’autres pratiques qui touchent la Falémé. Ce sont : les travaux provisoires de désenclavement (radiers), les déchets domestiques.
Assane Koné
Voir en ligne : Kéniéba : Attention la Falémé se meurt à cause de l’orpaillage